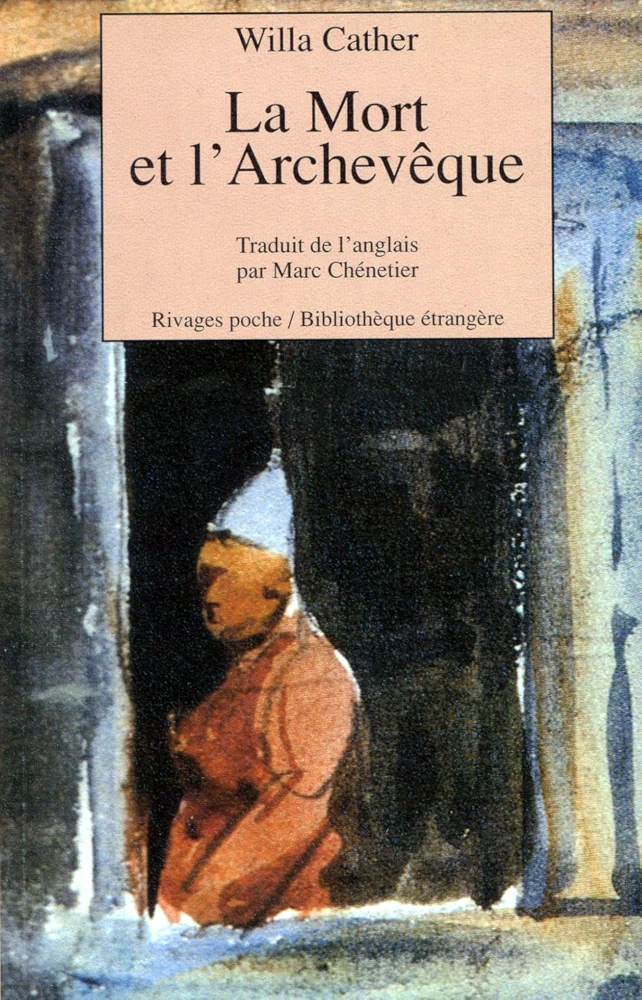L’auteure américaine, Willa Cather (1873-1947), considère cet ouvrage écrit en 1927 comme la meilleure de ses œuvres. Elle y raconte de façon romancée la vie au Nouveau Mexique d’un jeune prêtre français qui a quitté son Auvergne natale pour participer à la mission d’évangélisation des Indiens d’Amérique au XIXe siècle. Sur ce sujet qui ferait polémiques aujourd’hui, l’auteur décrit la splendeur aride de la région (qu’elle a parcourue), l’humilité de son héros, qui finira archevêque de Santa Fé, dans la façon d’aborder sa mission, et les questions que pose à cette auteur qui ne revendique pas elle-même de religion le sacrifice de ces prêtres et leurs renoncements au nom de leur vocation. Le père Jean Baptiste Latour, après la construction en grès local de la basilique Saint François de Santa Fé, sur le modèle d’une église française, rentra en France pour y finir ses jours, et se ravisa, retraversant l’Atlantique pour revenir mourir à Santa Fé (voir l’article « églises et sanctuaires du Nouveau Mexique », sur ce site).
« De la mer plane de sable rouge s’élevaient de hautes mesas, à la silhouette généralement gothique, pareilles à d’immenses cathédrales. Cette plaine, jadis, aurait tout aussi bien pu être une ville gigantesque, dont le temps aurait détruit les quartiers les plus insignifiants ne laissons debout que les édifices publics, – amoncellement architecturaux semblables à des montagnes. Le sol sablonneux de la plaine était parsemé de genévriers, taché ici et là de grosses masses d’herbe de Guttierez, cette plante olivâtre qui croit en hautes vagues comme une mer agitée, et couverte en cette saison d’un chaume fleuri jaune comme les genets ou oranges comme les soucis. Cette plaine de mesas semblait être d’un âge impressionnant ; elle paraissait inachevée, comme si, ayant rassemblé tous les matériaux nécessaires à la construction du monde, le créateur avait abandonné son entreprise, s’en était allé en laissant tout sur le point d’être assemblé, à la veille de se voir constituer en montagne, en plaine ou en plateau. Cette contrée continuait d’attendre qu’on la transformât en paysage.
La coutume indienne était de s’évanouir dans le paysage et non de se dresser contre lui. Les villages Hopi installés sur les mesas rocheuses étaient conçus pour ressembler à la roche sur laquelle ils se dressaient et, de loin, ne pouvaient s’en distinguer. Les huttes Navajo parmi le sable et les saules étaient faites de sable et de saule. Lorsqu’il quittait le rocher, l’arbre ou la dune qui les avait abrités pour la nuit, le Navajo prenait soin grand soin d’effacer jusqu’à la moindre trace de leur séjour temporaire. Il enterrait les braises et les restes de nourriture, il répandait les pierres qu’ils avaient pu empiler comblaient les trous qu’ils avaient faits dans le sable. Le père Latour en conclut que de même que l’homme blanc affirmait sa présence au sein des paysages en les changeant et en les modifiant, assez du moins pour y imprimer une marque quelconque de son passage, l’Indien, lui, traversait les pays sans y rien déranger passait sans laisser de traces tel un poisson dans l’eau ou les oiseaux fendant l’air.
Les pères espagnols qui étaient montés vers Zūni ,puis, plus au nord en pays Navajo à l’ouest, en pays Hopi et vers l’est, dans tous les pueblos éparpillés entre Albuquerque et Taos, étaient arrivés ,eux ,en terre hostile ne portant guère pour tout bagage que leur bréviaire et leur crucifix .Quand les indiens leur volaient leurs mules, ainsi qu’il arrivait souvent, ils continuaient à pied sans habits de rechange, sans vivres et sans eau .Il était pratiquement impossible à un Européen de s’imaginer pareilles épreuves .Les vieux pays avaient pris la forme même de la vie humaine étaient devenus pour l’homme investiture une sorte de second corps. Là-bas, herbes sauvages, fruits sauvages et champignons de la forêt étaient comestibles. De l’eau douce coulait dans les ruisseaux, les arbres fournissaient ombre et abri. Mais dans les déserts, les trous d’eau étaient empoisonnés et la végétation n’avait rien à offrir à l’homme. Tout y était sec, piquant et coupant et l’homme, enfin, rendu cruel par une existence cruelle. Ces missionnaires des premiers jours s’étaient jetés nus contre le cœur dur d’un pays fait pour éprouver leur résistance de géants. Ils avaient eu soif dans ces déserts, faim parmi ces rochers, avaient gravi et descendu ces terribles canyons, les pieds meurtris par les cailloux, mis fin à d’interminables jeunes en ingérant de sales et répugnantes nourritures. Ces hommes avaient assurément éprouvé « la faim, la soif, le froid et la nudité » à un point que ni Saint Paul ni Saint frères n’aurait pu concevoir. Quelles qu’aient été les souffrances des premiers chrétiens, ils les avaient supportées au cœur protégé du petit monde de la Méditerranée, parmi les us anciens et les anciens repères. S’ils avaient souffert le martyre, du moins étaient-ils morts parmi leurs frères, on avait conservé leurs reliques et leur nom vivait toujours dans la bouche des saints.
Il ne savait pas à quel moment au juste {cet air} lui était devenu si indispensable, mais s’il était revenu mourir en exil, c’était à cause de lui. Quelque chose de doux, de sauvage et de libre, quelque chose qui parlait en murmures à l’oreille reposant sur le traversin, rendait le cœur plus léger, crochetait doucement, tout doucement la serrure, faisait glisser les verrous et rendait l’âme humaine prisonnière à la liberté du vent, à la liberté du bleu et de l’or, et libre la rendait au matin ! »