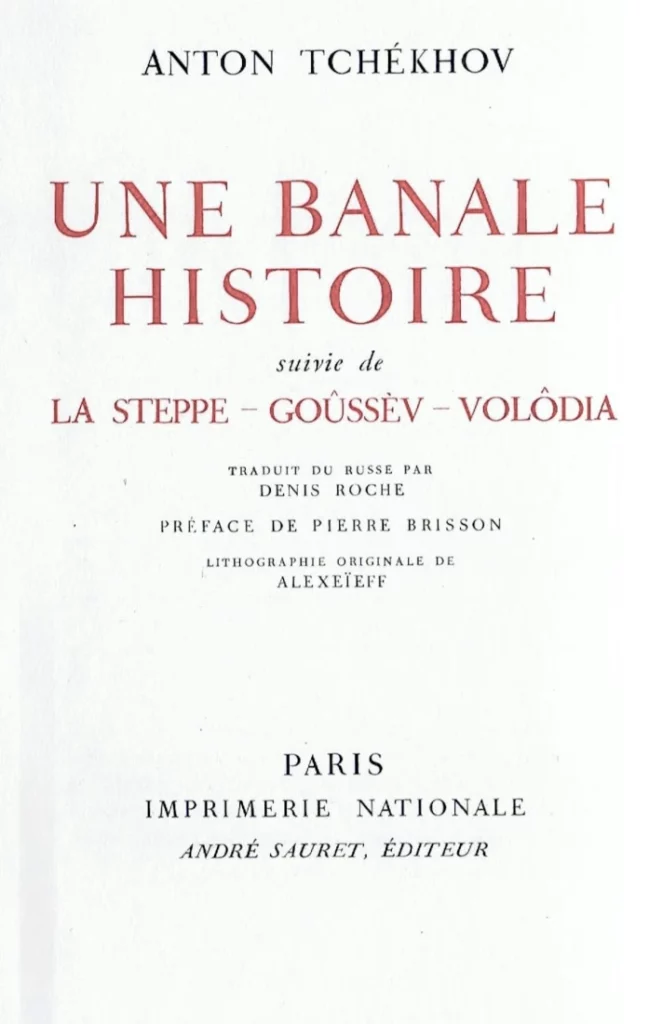Anton Tchekov (1860-1904), auteur russe prolifique de pièces de théâtre et de romans a écrit en 1888 « La steppe », la virée par la steppe du jeune Iégorouchka qui quitte ses parents pour entrer au collège à des centaines de kilomètres de chez lui, accompagné par son oncle dans une voiture à cheval. Une plume trempée dans le vent et le ciel qui délimitent vaguement ces vastes étendues de Russie, pour ce voyage initiatique auquel la splendeur et la majesté de la nature en ses expressions minérale, végétale et animale servent d’écrin. Si précisément décrite qu’un film en a été tiré, « La steppe » ( Sergueï Bondartchouk, 1978). Tchekov voulait qu’on lût son récit « comme un gourmet mange les bécasses ». Laissons-nous aller avec lui à notre appétit des mots.
« Un éclair brilla si fort qu’il illumina une partie de la steppe jusqu’à l’endroit où le ciel rencontrait l’obscurité. Un nuage effrayant s’avançait sans hâte de toute sa masse compacte ; au bout pendaient de grands lambeaux noirs ; des lambeaux tout pareils, s’écrasant les uns sur les autres, s’entassaient à droite et à gauche de l’horizon. Cet aspect haillonneux, décoiffé, donnait au nuage une allure d’ivresse, de canaillerie. Soudain le vent fila en sifflant à travers la steppe, tournoya au hasard, et fit dans l’herbe un tel bruit qu’on n’entendit plus le tonnerre ni le grincement des roues. Soufflant hors du nuage noir, il apportait avec lui des nuées de poussière et l’odeur de la pluie et de la terre humide. Le clair de lune s’embruma, s’encrassa presque, les étoiles se renfrognèrent encore plus, et l’on vit, le long de la route, les nuées de poussière et leurs ombres rebrousser chemin. On aurait cru que les tourbillons qui tournoyaient, arrachant à la terre sa poussière, ses herbes sèches et ses plumes, montaient jusqu’au ciel et à travers la poussière qui engluait les yeux, on ne voyait plus rien que l’éclat des éclairs. La noirceur du ciel ouvrit sa gueule et souffla un feu blanc. Aussitôt le tonnerre tonna de nouveau. Il y eut un ruissellement, un martèlement sur la route, sur les brancards, sur le ballot ; C’était la pluie. La pluie et la bâche, comme si elles s’étaient comprises, entamèrent un bavardage rapide, odieux et gai, comme deux pies. Sur les filets d’eau qui qui sillonnaient la bâche, il vit cinq ou six fois cligner une lumière corrosive, aveuglante. Le ciel ne tonnait plus, ne grommelait plus : il produisait des craquements secs, semblables à ceux du bois mort. Au début, les éclairs n’étaient qu’effrayants. Maintenant, mêlés à ce tonnerre-là, ils semblaient de mauvais augure. Leur lumière ensorcelée traversait les paupières closes et répandait des coulées de froid par tout le corps ».
Lorsqu’on regarde longuement un ciel profond, sans en détacher les yeux, on ne sait pourquoi les pensées et l’âme s’unissent en un sentiment de solitude. On commence à se sentir irréparablement seul, et tout ce qu’on avait naguère cru proche et cher devient infiniment lointain et perd tout prix. Ces étoiles, qui regardent du haut du ciel depuis des millénaires, ce ciel insaisissable et les ténèbres, indifférents qu’ils sont à la vie brève de l’homme, lorsqu’on demeure seul à seul avec eux et qu’on essaye d’en comprendre le sens, accablent l’âme par leur silence. On songe à la solitude qui attend chacun dans la tombe, et l’essence de la vie apparaît désespérée, atroce. (…) une tombe solitaire a quelque chose de triste, de rêveur et de poétique au plus au plus haut point…on l’entend se taire, et dans ce mutisme on sent la présence de l’âme de l’inconnu qui repose sous la croix. Cette âme se sent-elle à l’aise dans la steppe ? Ne se languit-elle pas par clair de lune ? Et la steppe qui entoure la tombe semble triste, maussade et pensive, l’herbe plus affligée, et les criquets crient à voix plus contenue… pas un passant qui ne dise une prière pour cette âme solitaire et ne se retourne pour voir la tombe jusqu’à l’instant où elle se couvre de ténèbres.